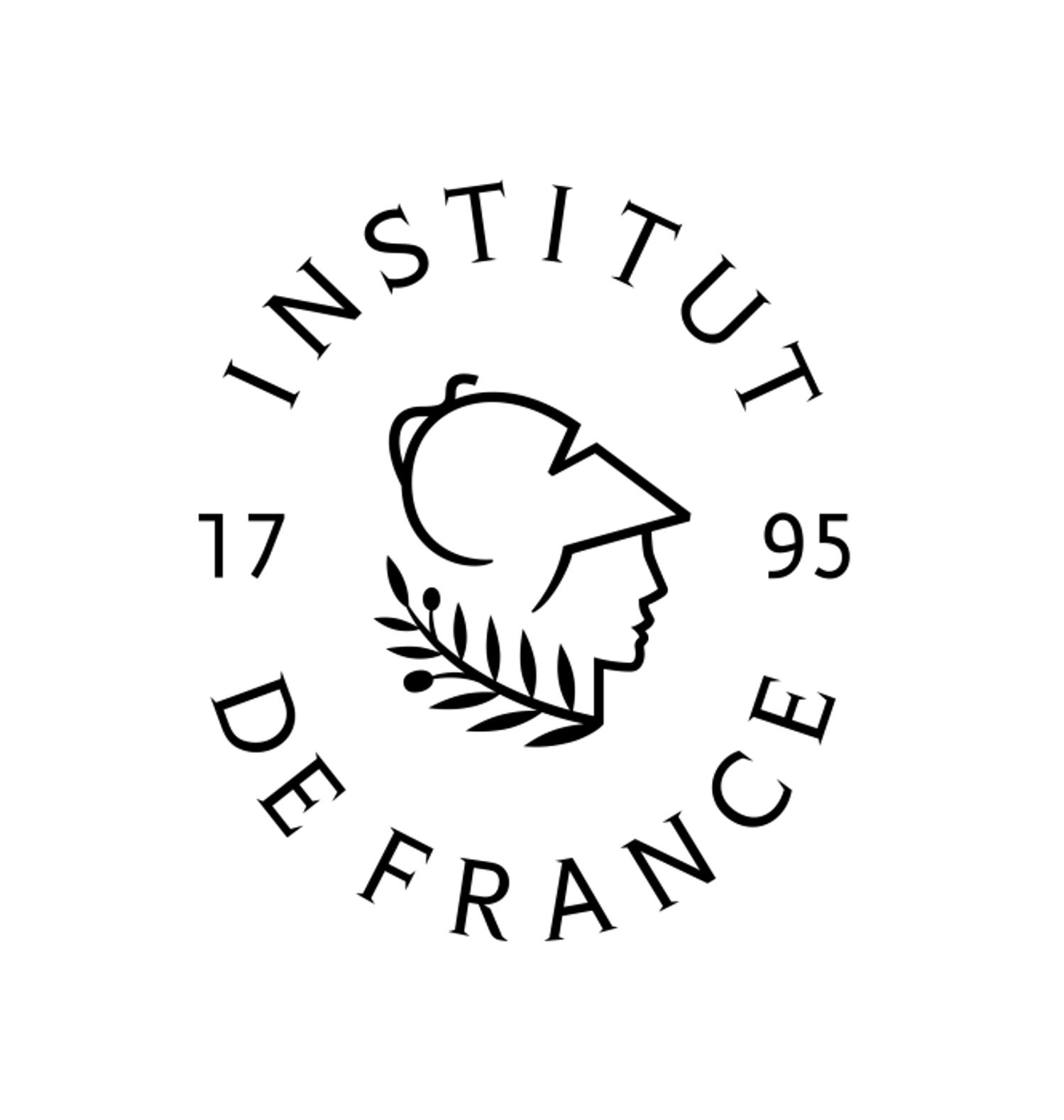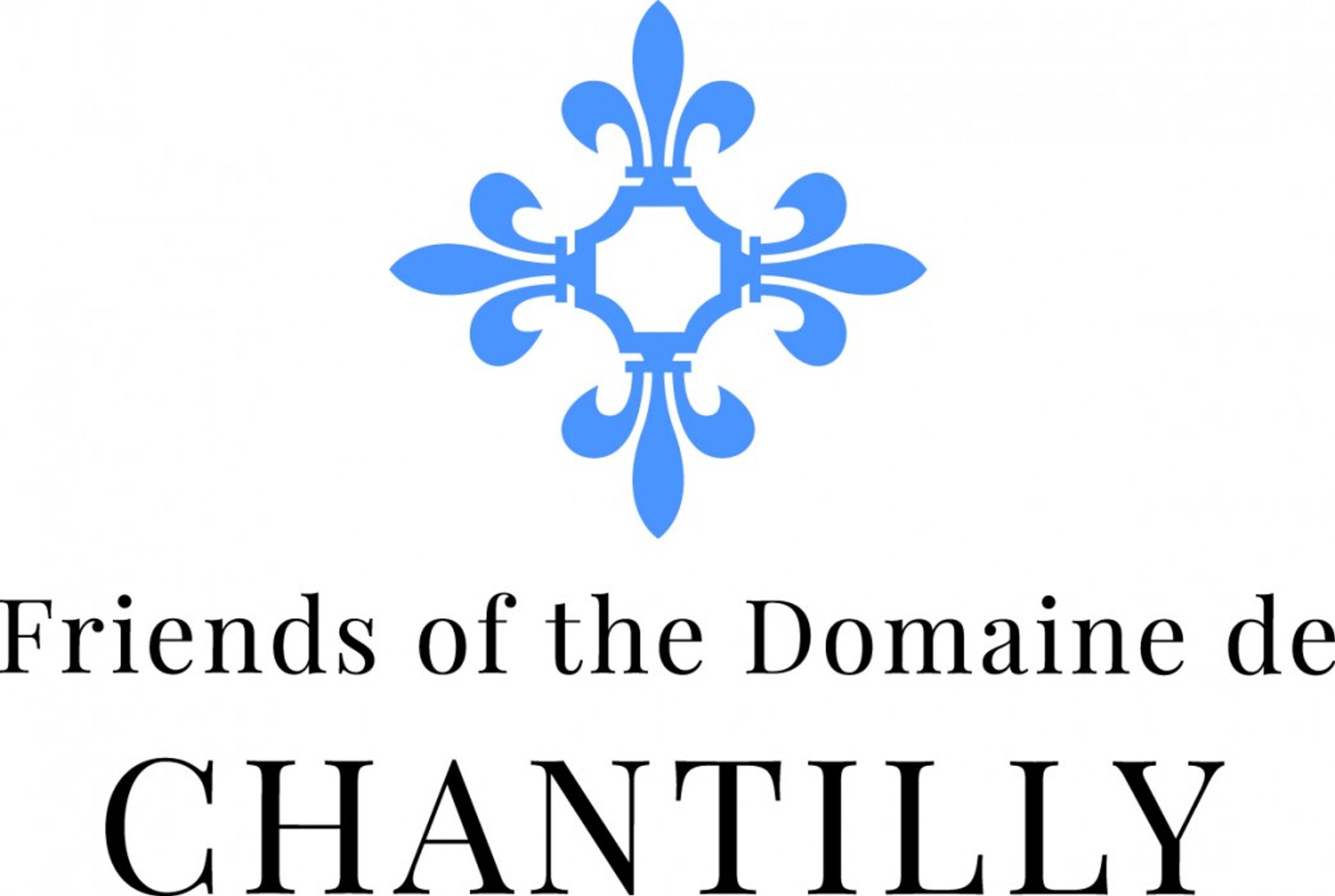Vue animée d’une forteresse aux armes de la princesse de Monaco : projet pour les jardins de Betz (Oise)
Titre
Vue animée d’une forteresse aux armes de la princesse de Monaco : projet pour les jardins de Betz (Oise)
Auteur
ROBERT Hubert
- NomROBERT
- PrénomHubert
- Date de naissance1733
- Lieu de naissanceParis
- Date de décès1808
- Lieu de décèsParis
- Nationalité / CultureFrançaise
- FonctionPeintre
- Notice biographiqueSurnommé « Robert des Ruines » par Catherine II et par Diderot, Hubert Robert (1733-1808), après un apprentissage comme dessinateur auprès du sculpteur Michel-Ange Slodtz (selon Mariette), se rend à Rome dans la suite de l’ambassadeur de France près le Saint-Siège le comte de Stainville (futur duc de Choiseul) pour qui travaillent ses parents. Il y demeure de 1754 à 1765, arrivant à se faire intégrer grâce à ses protecteurs Stainville et Marigny aux pensionnaires de l’Académie de France à Rome, alors dirigée par Natoire au palais Mancini, alors qu’il ne s’est pas présenté au concours du Prix de Rome. En 1760, il accompagne à Naples l’abbé de Saint-Non. Rentré à Paris en 1765, il est agréé et reçu dans la même séance, sans doute grâce à Marigny, comme peintre d’architecture à l’Académie royale de Peinture en 1766, connaissant des succès au Salon et recevant des commandes royales. A partir de 1767, il expose ses dessins au Salon, comme Boucher, mais lui ne les fait pas graver. Garde des Tableaux du Roi en 1777 sur la proposition du comte d’Angiviller, il demeure aux Galeries du Louvre dès 1778. Emprisonné sous la Terreur, il est en 1795 conservateur du Muséum, avant de s’éteindre sous l’Empire.
Depuis les amateurs n’ont cessé d’apprécier son goût pour le « pittoresque ruineux » (Edmond de Goncourt), allant même jusqu’à imaginer la Grande Galerie du Louvre en ruine : « Il faut ruiner un palais pour en faire un objet d’intérêt », selon Diderot. Travaillant sur le motif aux côtés de Fragonard, il voit ses sanguines confondues avec celles de l’artiste. Il dessine encore des sujets italianisants après son retour en France, puis devient le peintre de Paris.
Proche de Watelet dont il dessine dès 1766 la propriété Le Moulin-Joli à Colombes sur un bras de la Seine, et de Mme Geoffrin dont il fréquente les lundis, il devient dessinateur de jardins. Il crée en 1778-1780 le bosquet des bains d’Apollon à Versailles avec les sculptures de Girardon, dessine à Méréville en 1787 pour le fermier général Jean-Joseph de Laborde un temple rond inspiré de Tivoli (aujourd’hui remonté dans le parc de Jeurre). En 1785 on l’envoie à Fontainebleau s’occuper des jardins, il s’aventure à Amboise, Chaalis ou La Roche-Guyon et Saint-Rémy-de-Provence (1783). La tradition lui a parfois attribué à tort la paternité de la folie de Chartres à Monceaux, dessinée par Carmontelle pour le duc de Chartres (partie de l’actuel parc Monceau) et du Hameau de la Reine, comme le rappelle Pierre de Nolhac dans sa biographie Hubert Robert, Paris, 1910, p. 58 et 59. « Dessinateur des jardins du Roi », il a donné des dessins aussi pour le remaniement des jardins de Compiègne.
Date de création
1785 vers
Description
Dessin à la pierre noire collé en plein sur un montage en papier bleu avec filet à la plume et encre brune. Marque en creux à sec (L. 1042) de François Renaud, monteur en dessins et marchand à Paris la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.
Ce grand dessin à la pierre noire représentant des ruines médiévales a été exposé en 2017 au château de La Roche-Guyon dans l’exposition « Hubert Robert et les jardins » (p. 106-107, cat. 54). Cette œuvre poétique et d’un grand charme, bien dans la manière du Raphaël des ruines, qui aime à animer ses paysages de personnages au premier plan. Elle est de surcroît liée à l’histoire de Chantilly. Rares sont les dessins de Robert montrant des ruines du Moyen Age. Il ne peut s’agir d’un véritable château médiéval dessiné sur le motif, car comme nous l’a fait remarquer M. Dominique Allios, maître de conférences à l’université de Rennes 2, cette architecture militaire comporte des incohérences « en raison de la présence de verrières de part et d'autre du pont-levis » qui aurait fragilisé la sécurité du bâtiment en cas d’attaque ; pour lui, « cela ressemble à un projet de bâtiment néogothique ». Ceci corrobore les affirmations de Gabriel Wick (le donateur du dessin) et Sarah Catala, commissaires de l’exposition de 2017. Les armoiries en losange figurant au-dessus du-pont-levis sont celles d’Honoré Grimaldi, prince de Monaco (1720-1795), qui avait épousé en 1757 Marie-Christine de Brignole (Gênes, 1737-1813). La princesse de Monaco, malheureuse en ménage, avait obtenu la séparation de corps en 1770 et était devenue la compagne du prince Louis-Joseph de Condé (1736-1818), veuf à l’âge de vingt-quatre ans en 1760 ; ils ne se marieront que durant l’émigration en Angleterre le 25 décembre 1808, à l’extrême fin de leur vie, à l’âge de 69 et 72 ans. La princesse avait fait aménager entre 1783 et 1789 un jardin anglais dans le parc de son château de Betz, dans l’Oise, non loin de Chantilly, dépensant quatre millions en travaux. Le nom des concepteurs est donné par le poète Joseph Antoine Joachim Cerutti (1738-1792) qui publie en 1792 à Paris chez Desenne un poème écrit en 1785, Les Jardins de Betz, qui les décrit comme « les plus beaux jardins anglais qui soient en France » et affirme que « les ornements qu’il renferme (…) ont été rangés par M. d’Harcour et dessinés par le célèbre Robert ». Gouverneur du premier Dauphin, François-Henri, duc d’Harcourt (1726-1802) avait publié un Traité de la décoration des jardins et des parcs et est élu à l’Académie française en 1789. Il avait déjà collaboré en 1778 avec Robert à Brimborion, jardin de la marquise de Coislin à Meudon. Véritable pastiche, la conception du parc repose sur la vie imaginaire de deux personnages inventés, le croisé du XIIe siècle Thibault de Nanteuil, et son épouse bien-aimée Adéle de Crépy : personnages romantiques qui font clairement référence à la princesse de Monaco et à son amant Condé. Un manuscrit conservé aux Archives départementales de l’Oise, Notes sur le Vieux-Château de Betz, commentait cette histoire touchante. Pour le couple qui ne pouvait s’afficher à la cour en raison de leur liaison illégitime, cette œuvre dans l’air du temps était un appel à la sympathie et à la compréhension du public.
Le rôle d’Hubert Robert a été de créer une fausse ruine appelée « Vieux Château ». Comme l’écrit Cérutti :
« Le Raphaël des paysages,
Le poète des temps, Robert, a crayonné
Ce château pittoresque en naissant ruiné.
L’artiste en les formant mutila ses ouvrages ;
Les longs siècles pour eux furent de courts instants.
Chaque coup de marteau leur imprima cent ans ».
Matière et technique
Papier
Pierre noire
Mesures
Hauteur en cm : 28.5
Longueur en cm : 37
Hauteur avec montage en cm : 37
Longueur avec montage en cm : 47
Hauteur avec cadre en cm : 41
Longueur avec cadre en cm : 51.2
Inscriptions / marques
Annotation
dans la marge
Robert
Sujet / thème
Paysage animé
; Château
; Ruines
Lieu représenté
Betz
Acquisition
2021 Don Wick
Notes
Acquisition validée à la commission scientifique régionale d’acquisition du 18 mars 2021
Bibliographie
Bulletin du musée Condé 2021 n°79
P.49-51
Exposition
Ce dessin a été exposé en 2017 au château de La Roche-Guyon dans l’exposition « Hubert Robert et les jardins ».
Bibl. : Wick, dans exposition 2017, La Roche-Guyon, Hubert Robert et la fabrique des jardins, p. 106-107, cat. 54, repr
Domaine
Dessin
Numéro d'inventaire
2021-4-1
Facettes
Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.